 Les services de renseignement, qui ont connu une importante évolution technologique avec la numérisation de leurs données et de leurs communications, s'efforcent désormais d'adopter les outils 2.0 que constituent les wikis, les réseaux sociaux et les plateformes collaboratives, afin de mutualiser leurs efforts de collecte et de travailler efficacement à des analyses communes.
Les services de renseignement, qui ont connu une importante évolution technologique avec la numérisation de leurs données et de leurs communications, s'efforcent désormais d'adopter les outils 2.0 que constituent les wikis, les réseaux sociaux et les plateformes collaboratives, afin de mutualiser leurs efforts de collecte et de travailler efficacement à des analyses communes.Le 11 septembre et l'introspection qui a suivi au sein de la communauté du renseignement, ont forcé les agences à se moderniser, alors qu'au début des années 2000, tous les analystes de la CIA ne disposaient pas encore d'une connexion à internet. Cette conversion au web ne s'est pas faite sans difficulté, notamment pour la vieille garde des analystes qui regardait internet avec circonspection, voire méfiance. C'est notamment pour cette raison que les agences ont fait appel à de jeunes recrues en provenance des universités et du secteur privé pour travailler à cette transformation. Au programme de cette cure de jouvence, numérisation de l'espace de travail, investissements dans des startups spécialisées (Keyhole, Palantir, Visible Tech.), adaptation d'outils 2.0 grand public, mais aussi d'applications issues du logiciel libre.
Les wikis
Les wikis sont des logiciels qui permettent la création rapide de documents multimédias favorisant la mise en commun d'informations, avec une forte dimension collaborative, facilitant la création et la modification des documents par de multiples utilisateurs en temps-réel. Dans le cadre du renseignement, les wikis sont employés pour partager des informations, telles que des fiches d'identité, des documents techniques ou des comptes rendus, ainsi que pour partager des bases de données qui peuvent être complétées, corrigées et commentées en temps-réel par les utilisateurs. Les wikis peuvent s'étendre à l'échelle d'une ou plusieurs agences de renseignement, mais peuvent également être restreints à une seule opération, ou à un seul théâtre. Intellipedia, le wiki géant de la communauté du renseignement US lancé en 2006, est l'exemple phare en la matière. Intellipedia est deployé sur trois réseaux (JWICS, SIPRnet et Intelink-U), avec un accès restreint en fonction du niveau d'accréditation de l'utilisateur.
Basé sur les technologies développées par Google, il regroupe plus de 100 000 utilisateurs, avec près d'un million de pages créées jusqu'à présent. Malgré ces chiffres impressionnants, Intellipedia n'est pas un outil idéal, confronté aux mêmes problèmes que les wikis grand public, à savoir l'abondance d'informations et d'opinions contradictoires, mais également la frilosité des agents les moins geeks qui se montrent réticents à y participer, plus de trois ans après son lancement. Au cours d'opérations de renseignement, d'autres wikis se révèlent très utiles, pour faciliter la communication entre opérateurs et analystes, avertir en temps réel des développements d'une phase de recueil de l'information et permettre à chaque utilisateur de partager des informations, de collaborer à une analyse, de réorienter une collecte de renseignement et de réduire les cycles de feedback. Les wikis sont aussi au cœur des exercices interarmées, tels que les exercices ISR Empire Challenge.
Les réseaux sociaux
La communauté du renseignement a pris conscience de l'intérêt des réseaux sociaux, tels que Facebook, pour permettre à ses effectifs, répartis dans plusieurs agences et parfois géographiquement éloignés, de collaborer en temps-réel. Depuis 2008, les agents de renseignement américains disposent de leur propre réseau social, baptisé A-Space (Analytical Space), déployé sur le réseau JWICS et qui compte plus de 10 000 utilisateurs. À l'instar de Facebook, il permet aux agents de communiquer en temps-réel, de partager des contenus multimédias avec de nombreux utilisateurs sur des thèmes précis et de contacter rapidement un spécialiste situé à l'autre bout du monde pour faire appel à ses compétences. A-Space permet de maintenir une certaine cohésion dans la communauté du renseignement, d'initier des débats, de stimuler la réflexion des analystes, mais aussi de soumettre l'analyse de sujets complexes à un véritable crowdsourcing. Ce réseau social favorise aussi la constitution très rapide d'équipes d'experts lors d'une situation de crise, comme ce fut le cas pendant les attentats de Mumbaï. Les analystes du renseignement américain exploitaient deux autres outils 2.0, le client de messagerie uGov et l'outil collaboratif BRIDGE, jusqu'à l'interruption récente de ces services pour des raisons de sécurité, suscitant l'ire des utilisateurs. Les analystes du GCHQ britannique peuvent, pour leur part, avoir accès un à véritable mySpace pour fonctionnaires, baptisé Civil Pages, dont la sécurité a été renforcée pour accueillir ces agents de renseignement.
Google Earth, chats, IM et cætera
Google Earth est l'application qui a connu un des succès les plus fulgurants dans la communauté du renseignement. L'accès instantané à de l'imagerie satellite, à des cartes et des prises de vues du monde entier a rapidement séduit les analystes. Le logiciel développé par Google est utilisé pour se procurer de l'imagerie à moindre coût, mais également pour pointer les éléments d'un rapport, géotagger des contenus multimédias, créer des cartes collaboratives ou encore planifier et suivre en temps réel le déroulement d'une opération ou d'un exercice.
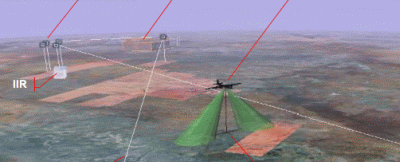
Les acteurs du renseignement font un usage intensif d'autres applications venues du monde civil, tels que les webchats, pour organiser des réunions, coordonner leurs activités en cours, voire communiquer pendant une opération. Il en est de même pour les messageries instantanés qui ont pris le pas sur les courriels et le téléphone pour communiquer au sein des agences de renseignement. Les services de renseignement exploitent aussi les applications grand public du web. Les moteurs de recherche et leurs dernières fonctionnalités, telles que la recherche d'image, la reconnaissance de lieux ou de visages, la traduction automatique ou encore le sous-titrage de contenus vidéos, sont utilisés par les agents qui prennent soin de se protéger derrière des proxies et des tunnels.
Le web 2.0 comme source du renseignement
Le recours aux sources ouvertes est une pratique ancienne pour les services de renseignement et l'arrivée d'internet a sans aucun doute fait exploser leur consommation en la matière. Le web 2.0 permet aux agences de renseignement d'accéder à un autre niveau en matière d'information, celui du temps réel et de la variété des contenus diffusés. Les réseaux sociaux tels que Facebook permettent aux agents de réunir des éléments biographiques sur les individus qui les intéressent, d'établir des liens entre ces individus et d'identifier des groupes. Ces réseaux, mais également les plateformes d'échange de contenus multimédia tels que Youtube ou Flickr, donnent accès aux agences à une quantité phénoménale d'images, de sons et de vidéos relatifs à des évènements ou des lieux situés aux quatre coins du monde, y compris dans les régions les plus reculées ou les plus fermées. Les espions peuvent également suivre en temps-réel le déroulement d'évènements importants, telles que les manifestations en Iran, grâce à des applications comme Twitter.
Les forces armées, dépassées par le phénomène du web 2.0 et des blogs de soldats, ont fini par implémenter des règles pour permettre à leur personnels d'utiliser ces outils, sans pour autant impliquer la responsabilité de leur commandement. Elles mettent en œuvre de nouvelles veilles informationnelles pour surveiller les réseaux sociaux et les blogs, à la recherche d'informations sensibles qui pourraient mettre en péril la sécurité de leurs opérations (OPSEC), à l'image d'une nouvelle unité de l'US Army, baptisée Army Web Risk Assessment Cell. Le monde du renseignement évolue désormais du concept de "chaque soldat est un capteur" à celui de "chaque internaute 2.0 est un capteur".

 La Direction Générale de l'Armement vient de publier l'édition 2009 de son plan stratégique de recherche et technologie de défense et de sécurité, qui établit notamment les grands axes de la R&D française en matière de renseignement.
La Direction Générale de l'Armement vient de publier l'édition 2009 de son plan stratégique de recherche et technologie de défense et de sécurité, qui établit notamment les grands axes de la R&D française en matière de renseignement. Les médias français et espagnols révèlent les détails d'une mission menée par une équipe du service action voici sept ans, en Espagne.
Les médias français et espagnols révèlent les détails d'une mission menée par une équipe du service action voici sept ans, en Espagne.
 L'Union Européenne finance un programme de recherche visant à créer un système de surveillance automatisé capable de recueillir du renseignement à partir du web et d'images de vidéosurveillance.
L'Union Européenne finance un programme de recherche visant à créer un système de surveillance automatisé capable de recueillir du renseignement à partir du web et d'images de vidéosurveillance.
 Alors que huit terroristes présumés ont été récemment jugés par la justice britannique pour avoir planifié une attaque sur des vols longs courriers, un ancien haut-responsable du
Alors que huit terroristes présumés ont été récemment jugés par la justice britannique pour avoir planifié une attaque sur des vols longs courriers, un ancien haut-responsable du